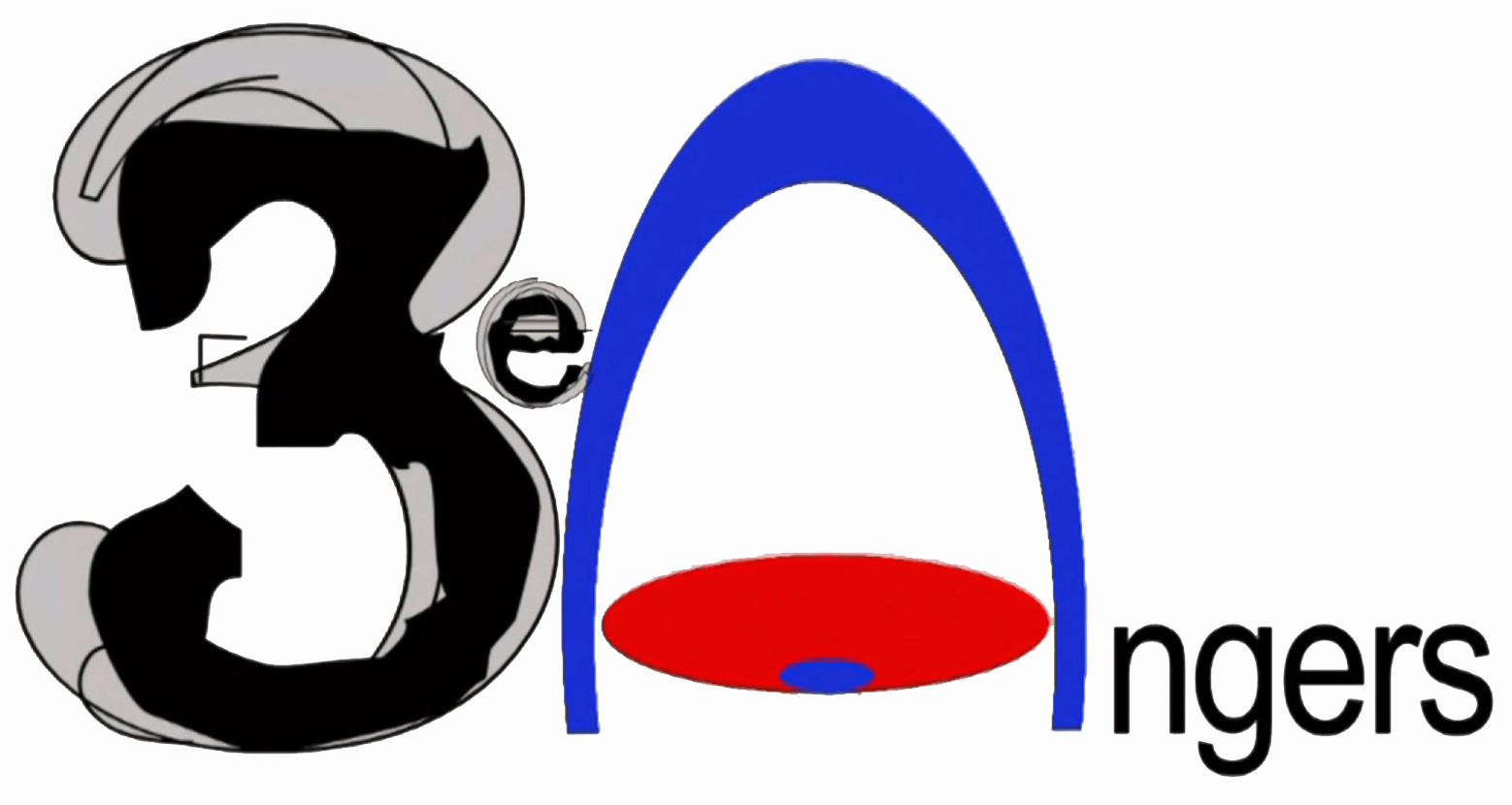Yann Dedet (monteur)
est dans Boomerang sur France Inter
par Augustin Trapenard
En cinquante ans de carrière, tel un sculpteur dont la matière serait l’image, il a façonné des films comme “La nuit américaine” de Truffaut, “À nos amours” de Pialat, ou encore “Polisse” de Maïwenn qui lui valait le César du meilleur montage en 2012. Le monteur Yann Dedet est l’invité d’Augustin Trapenard.
Son nom rime avec Truffaut, Pialat, Stévenin ou Garrel. Le spectateur zéro, un livre d’entretiens avec Julien Suaudeau retrace son parcours. Il est venu nous parler d’un métier de l’ombre, d’artisanat et de regard. Le cinéaste et monteur Yann Dedet est dans Boomerang.
Pour sa carte blanche, Yann Dedet a choisi de parler d’une scène de À nos amours de Maurice Pialat
Dans quelle mesure le monteur est-il un metteur en scène ?
Yann Dedet : Je dirais par amour. Quand on travaille avec des gens qu’on aime, on tombe vite amoureux de la matière qu’ils filment et on a envie de la posséder. C’est assez pervers et ca peut être assez dangereux. D’où les conflits quelquefois graves avec les réalisateurs. Si on a des avis très fermes sur la façon de monter quelque chose, on a envie de prendre une part de son pouvoir, alors que c’est son film. C’est toujours le réalisateur qui décide. Mais nous, on propose notre vision du film. C’est un peu un danger cette envie de possession !
Que le nom du monteur soit à la fin du générique est normal : le montage est la dernière opération, l’opération définitive. Après ça, il n’y a plus rien, sauf le mixage, le mélange des sons avec le montage des images. Il ne faut pas se louper !
Le montage est le dernier scénario. Et s’il n’est pas bon, c’est gravissime.
Un œil attentif à toutes les images
Y D : Je regarde toujours si un montage est rigoureux par rapport au sujet du film, s’il est en accord avec son fond et sa forme. On ne monte évidemment pas un film de Truffaut comme un film de Pialat. On ne monte pas une série comme on monte, un film de fiction d’une heure et demie, ou plus.
Je n’ai pas de détestation spéciale pour le montage trop rapide. Les films en 500 plans, me gonflent un peu, mais dans les films de Nolan, par exemple, cette façon de faire s’applique très bien aux sujets qu’il traite.
Le nécessaire conflit
Y D : Quand tout est monté de la même façon, le risque, c’est l’uniformisation.
Souvent pour monter un premier film quand on est un jeune réalisateur, on demande à un ami de sa génération. Or cette amitié donne des points de vue assez semblables, et entraîne une certaine complaisance et une certaine régularité qui nuit au film.
Il faut qu’il y ait du conflit. Comme dans l’amour. C’est important, par exemple, de ne pas avoir les mêmes avis, surtout avec son conjoint ou sa conjointe.
Dans une équipe, souvent pour le tournage on n’est plus que deux. Auparavant, on était quatre : le metteure en scène, un monteur, un assistant, ou une assistante et un stagiaire ou une stagiaire. Donc, le dialogue était un quadrilingue. C’était assez agréable cet esprit d’équipe. Maintenant, on a toujours un rapport avec l’assistante. Mais c’est moins chaleureux qu’avant. Et on n’est plus que deux au centre.
Un film a ses propres lois
Y D : Un film a ses lois. Je dis souvent que ce sont les rushes qui apprennent au monteur comment les monter. Les rushes, c’est déjà une leçon. Je n’ai pas besoin que le réalisateur m’explique comment monter une scène. Il peut choisir les prises. Mais je ne le respecte pas toujours parce qu’en fonction du plan 1, le plan 2 n’est plus le même.
La première règle à la laquelle on déroge : c’est le respect du plan séquence. On peut faire des ellipses dans des plans séquences. C’est criminel. Mais la Coupe est criminelle. Hitchcock avait raison de faire La corde (1948).
Un beau, un vrai beau film devrait être en un seul plan
Que ce soit en 2500 plans ou en 400, si c’est un film de François Truffaut, l’idée, est d’essayer de donner de la fluidité de faire comme si c’était un seul mouvement.
Une humilité nécessaire devant son film
Y D : J’écris dans le livre “certains réalisateurs confondent leur “moi” et leurs films et ne supportent pas d’être bousculés, pensant qu’ils sont sur la sellette. C’est comme si on leur volait le statut de démiurge alors qu’ils devraient se féliciter de n’être que les serviteurs de leurs films.” Certains se mettent devant leur film, mais pensent que leurs réflexions, leur état d’esprit, ce qu’ils sont eux-mêmes, est plus important que l’œuvre qu’ils sont en train de faire. Or il faut qu’il soit asservi.
Des ratages qui font progresser
Y D : Sur le film Le Fils préféré (1994) de Nicole Garcia, j’ai été éjecté, mais comme la vie est compliquée, et que c’est très douloureux d’être viré par une amie… J’ai retravaillé un peu dessus. Mais elle avait raison, j’étais tellement critique, que j’aurais saboté son film. Je voulais enlever trop de choses…
Je sortais de Passe-Montagne de Jean-François Stevenin. Il avait inventé pour ce film un montage elliptique extraordinaire : je n’ai fait qu’une seule coulure. J’ai certainement trop voulu suivre cette façon de faire, et je voulais mettre des coups de sabre partout.
Chaque fois que l’on se trompe, on peut pleurnicher, mais on apprend.
“A nos amours” (1983) de Pialat l’a convaincu de rester monteur
Y D : Ce film est arrivé alors que je voulais arrêter le montage pour essayer d’être acteur. Je venais d’avoir un accord pour jouer dans L’Histoire du Caporal de Jean Baronnet. Maurice Pialat m’invite à voir les rushs d’A nos amours et je vois la séquence avec Sandrine Bonnaire dans un bar de la ville de Hyères qui se fait draguer par un Américain… Et là, je tombe par terre, et mes envies d’être acteur avec, pour retourner bien évidemment au montage.
Comme disait Maurice en recevant le César. « Je suis ici par la grâce d’une interprète. » On a tout à coup à l’image quelqu’un qui envahit totalement l’espace. Elle mange tout. C’est une déesse. A ce moment-là, bien sûr, j’ai eu envie de monter le film. J’avais déjà travaillé sur le montage Loulou de Pialat, donc j’avais déjà goûté au plaisir intense de monter des films avec Maurice. Là, il y avait en plus cette révélation extraordinaire : Sandrine Bonnaire.
De l’importance du cadre pour une belle image
Y D : Habitué à voir des films, j’apprécie la beauté d’un cadre ou d’un mouvement, mais s’il est habité. Et je vois souvent un cadreur appliqué à savoir ce qu’il y a au bord de son cadre et non au centre : c’est catastrophique. A la fin de ma vie professionnelle, j’ai pu faire du cadrage. C’est la même chose : au montage on découpe du temps, et au cadrage, de l’espace. Mais ça ne date pas d’aujourd’hui. Truffaut recadrait beaucoup.
Le son de la caméra
Y D : Dans les films, on entend parfois le son de la caméra comme dans la scène où j’ai joué dans Sous le soleil de Satan avec Sandrine Bonnaire. Les mixeurs ont essayé de filtrer ce bruit de caméra pour qu’on ne l’entende plus. Mais filtrer un son, ça abîme le médium des voix humaines. Maurice Pialat a préféré garder le son de la caméra. J’étais très content qu’il soit dans cette rigueur extraordinaire qui fait qu’on sauve la voix, même si on entend la caméra.
La vocation
Y D : Vers mes 11 ans, j’ai reçu une caméra Fireball X 8mm On faisait de petits scénarios à la gomme avec mon frère, mes cousins et les amis. On filmait ma famille, mon oncle… Puis, j’essayais de les monter. J’avais un projecteur, une bande 6’25, et un magnétophone pour le son.
On faisait tout en même temps : on tripotait une bassine d’eau pour montrer qu’on était en train de nager en même temps qu’on doublait les voix !
Après, je suis allé dans un auditorium de doublage, sur le micro de gauche, le bruiteur faisait les pas, etc. Sur celui de droite, les acteurs doublaient en français les films américains : c’était extraordinaire. Parce qu’évidemment, c’était toujours la synchronisation des acteurs qui était choisie. Et les bruitages, c’était n’importe quoi !
Le cinéma est art du bricolage
Y D : Je pensais devenir acteur. Mais ce n’était pas pour moi. A l’époque pour être monteur, il fallait passer par le laboratoire. J’ai fait un stage de six mois grâce à Marie-Josèphe Yoyotte. J’ai donc tripoté de la pellicule, senti l’odeur des bains…
C’était un univers où tout le monde était en blouse et en gants blancs. La pellicule est une matière fragile. Il y a les bains chimiques à l’odeur plus qu’entêtante qui faisait souvent mal à la tête. D’ailleurs, ceux qui travaillaient-là devaient finir leur vie avec des poumons très abîmés.
Et puis, il y avait tous les services. J’en ai compté 18 par lesquels la pellicule passait entre son entrée une fois que la pellicule est impressionnée, jusqu’à la sortie en copie standard pour les salles. Il y a un nombre d’opérations incroyable : l’étalonnage, le développement, la synchronisation des rushs, le montage négatif, etc. Et tout ça pour construire un film !
Illusion de vérité
Y D : Je ne suis pas tellement dans l’idéal contemporain de vouloir faire illusion, de faire croire que c’est vrai.
On ne croit jamais que c’est vrai. C’est reconstruit, comme la littérature. La littérature et le cinéma sont mieux que la vérité !
La vérité filmée, le documentaire est ce qu’il y a de plus dur à faire.